« Chaque pays déclare ce qu’il déclare et promet ce qu’il promet. » Voici un bon résumé de l’enquête publiée par le Washington Post, traduite ci-dessous.
EXTRAITS
L’Iran, l’un des 10 principaux responsable des émissions carbone au monde, n’a pas déposé son rapport depuis 2010 ; le Qatar, important producteur de gaz naturel, ne l’a présenté pour la dernière fois qu’en 2007 ; et l’Algérie, important producteur de pétrole et de gaz, en 2000. La Chine, premier émetteur mondial, n’a pas déclaré ses émissions depuis son dernier rapport de 2014. La Malaisie affirme que ses forêts absorbent quatre fois plus de carbone que les forêts similaires de l’Indonésie voisine. Ce qui a permis au pays de soustraire plus de 243 millions de tonnes de carbone de son (dernier) rapport en 2016.Au final les Nations unies ne disposent pas d’une base de données complète ni cohérente pour agréger les émissions de carbone des pays. Ce qui résulte de règles inconsistantes, rapports parcellaires pour certains pays, erreurs délibérées pour d’autres – outre le fait que, globalement, la déclaration des émissions anthropiques n’est pas contraignante. Et si 148 pays n’ont pas présenté de rapport pour l’année 2019, quelques 45 pays n’ont pas communiqué de nouvelles données depuis 2009.« Il n’est pas surprenant que les gouvernements cherchent à s’arranger avec les chiffres », a déclaré M. Hurowitz, « mais il est honteux qu’ils puissent s’en tirer à si bon compte. »
Le grand écart en question s’applique à de colossales quantités d’émissions manquantes de carbone et de méthane. L’écart s’échelonne d’au moins 8,5 milliards de tonnes à 13,3 milliards de tonnes par an d’émissions non déclarées, ce qui est plus que suffisant pour rendre caduque les meilleures estimations du réchauffement climatique.
- Si l’on s’en tient à l’écart minimal, soit 8,5 milliards de tonnes par an d’émissions non déclarées, celles-ci sont déjà supérieures aux émissions annuelles des États-Unis.
- À l’autre extrême, soit 13,3 milliards de tonnes par an, on se rapproche des émissions de la Chine, ce qui représente 23% de la contribution anthropique au réchauffement de la planète.
Autrement dit, les chiffres avancés sont sujets à des marges d’erreurs colossales. Au final, le bilan déclaratif des émissions n’est pas autre chose qu’une conjecture, un cas de « garbage in, garbage out » [en informatique, on parle de GIGO (pour « garbage in, garbage out »), un concept selon lequel les meilleures modélisations peuvent, dès lors que les données d’entrée sont faussées ou absurdes, produire en sortie des résultats absurdes, dits « déchets ». Ndlr].
Les négociateurs climatiques savent depuis des décennies que ce processus de collecte de données n’est guère réaliste. M. Saier, le porte-parole de la CCNUCC, a confirmé que, « concrètement, une mise à l’échelle était effectuée ». Au final, la CCNUCC compense donc les valeurs déclarées pour qu’au final il y ait correspondance avec les données mondiales globales, ce qui permet à priori d’éliminer l’écart constaté par le Washington Post. Ce qui pose un gros problème donc, c’est la répartition des estimations par pays. Et là, impossible de parler de compensation équilibrée et juste. Pour faire court, au niveau international, il est possible d’avoir une bonne vision d’ensemble. En revanche, aux niveaux nationaux, c’est le flou artistique presque total, qui permet d’imputer des émissions et « torts » au petit bonheur la chance entre différents pays et continents. Ce qui ouvre la voie à toutes les erreurs d’interprétation, aux divergences nord-sud, ou encore à la difficulté de tenir une négociation en toute objectivité, par exemple lors de la Cop26, ou à la possibilité de décider en toute connaissance de causes de stratégies coordonnées et cohérentes à l’échelle internationale…
__________________________________
Les engagements des pays en matière d’émissions carbone reposent sur des données erronées
2021-11-07 – Washington Post : Chris Mooney, Juliet Eilperin, Desmond Butler, John Muyskens, Anu Narayanswamy and Naema Ahmed (Countries’ climate pledges built on flawed data, Post investigation finds) Traduction : DeepL / J.Cherix
Source: WashingtonPost – Countries’ climate pledges built on flawed data, Post investigation finds
Le dernier rapport sur les émissions de gaz à effet de serre de la Malaisie présenté aux Nations unies semble tiré d’un monde parallèle. Le document de 285 pages fournit par la Malaisie déclare que ses forêts absorbent quatre fois plus de carbone que les forêts similaires de l’Indonésie voisine. Ce qui a permis au pays de soustraire plus de 243 millions de tonnes de carbone de son inventaire de 2016, soit une réduction de 73% de ses émissions. Partout dans le monde, les pays sous-déclarent leurs émissions de gaz à effet de serre dans leurs rapports aux Nations unies.
Selon une enquête du Washington Post, l’examen de 196 rapports nationaux révèle un écart considérable entre les émissions déclarées par les pays et les gaz à effet de serre qu’ils rejettent dans l’atmosphère. L’écart s’échelonne d’au moins 8,5 milliards de tonnes à 13,3 milliards de tonnes par an d’émissions non déclarées, ce qui est plus que suffisant pour rendre caduque les meilleures estimations du réchauffement climatique. Les stratégies visant à éviter les pires effets du changement climatique reposent sur des données. Sauf que les données sur lesquelles tous s’appuient sont faussées.
Rob Jackson, professeur à l’université de Stanford et président du Global Carbon Project déclare :
« Si nous ne pouvons pas évaluer la réalité des émissions actuelles, nous n’avons aucun moyen de savoir si nos stratégies de réduction des émissions conduisent à des résultats significatifs et substantiels »
Rob Jackson
Si l’on s’en tient à l’écart minimal, soit 8,5 milliards de tonnes par an d’émissions non déclarées, celles-ci sont déjà supérieures aux émissions annuelles des États-Unis. À l’autre extrême, soit 13,3 milliards de tonnes par an, on se rapproche des émissions de la Chine, ce qui représente 23% de la contribution anthropique au réchauffement de la planète. Alors que des dizaines de milliers de personnes se réunissent à Glasgow pour la COP26, qui pourrait être la plus grande réunion jamais organisée dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les chiffres retenus pour orienter les efforts mondiaux de réduction des gaz à effet de serre se révèlent être, d’emblée, farfelus. Autrement dit, le défi se révèle bien plus compliqué à résoudre que ce que les dirigeants mondiaux ont reconnu.
« Au final, le tableau est fantaisiste, a déclaré Philippe Ciais, un scientifique du Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (France). Parce qu’entre une réalité déclarative et la réalité des émissions, le grand écart semble la règle ».
La CCNUCC enregistre les rapports déclaratifs des pays dans le cadre de l’accord de Paris signé en 2015 avec l’objectif de réduire progressivement les émissions. Laconiquement, l’agence onusienne attribue les écarts identifiés par le Washington Post à « la conséquence de différentes méthodes de mesure et à des incohérences apparentes consécutives à la pertinence des rapports (par exemple pays développés vs en développement, ou entre pays en développement). »Le porte-parole Alexander Saier, à la question de savoir si les Nations unies escomptaient combler cette lacune, a répondu dans un courriel qu’elles poursuivaient leurs efforts pour consolider le processus d’établissement des rapports : « Cependant, nous reconnaissons qu’il faut faire aller plus loin, notamment développer des moyens afin de fournir un soutien aux pays en développement pour améliorer leurs moyens institutionnelles et techniques. »
Le grand écart en question s’applique à des quantités colossales d’émissions manquantes de carbone et de méthane, ainsi qu’à de plus petites quantités de puissants gaz de synthèse. Il résulte de règles inconsistantes, de rapports parcellaires pour certains pays, et d’erreurs délibérées pour d’autres – outre le fait que, globalement, la déclaration de l’ensemble des impacts anthropiques n’est pas contraignante.
L’analyse du Washington Post s’est basée sur des données reconstituées à partir des émissions communiquées par les pays aux Nations unies sous divers formats. Pour combler les années manquantes, les journalistes ont utilisé un modèle statistique pour estimer les émissions que chaque pays aurait du déclarer en 2019, puis ont comparé ces données à d’autres ensembles de données scientifiques concernant les gaz à effet de serre. L’analyse a révélé qu’au moins 59% des écarts proviennent de la manière dont les pays comptabilisent les émissions provenant des terres, un secteur tout particulier en ce qu’il peut tout à la fois aider et nuire au climat. Les terres peuvent absorber du carbone grâce à la croissance des végétaux ou à la séquestration des sols, comme inversement peuvent renvoyer dans l’atmosphère de colossales quantités de carbone lorsque les forêts sont exploitées ou brûlées ou que les tourbières sont drainées. L’un des principaux sujets de controverse est lié au fait que de nombreux pays considèrent compenser leurs émissions dues à la combustion de combustibles fossiles par la séquestration des terres situées sur leur territoire. Les règles de l’ONU permettent effectivement à des pays comme la Chine, la Russie ou les États-Unis de soustraire chacun plus d’un demi-milliard de tonnes d’émissions annuelles de cette manière, et pourraient permettre à ces pays comme à d’autres de continuer à rejeter des émissions importantes tout en se prétendant « net zéro » ». En d’autres termes, une grande partie de l’écart en question (59%) est consécutive à de simples soustractions que les pays effectuent dans leurs bilans. Or de nombreux scientifiques estiment que les pays ne devraient pouvoir prendre en compte ces formes de déduction de gaz à effet de serre que lorsqu’ils mettent en place des mesures délibérées et constructives, et non au prétexte de la présence naturelle de forêts indépendamment de toute politique nationale. D’autant que les estimations de séquestration de carbone ne sont pas réalistes – du moins pas aux niveaux déclarés par les pays. La Malaisie, par exemple, a rejeté 422 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2016, ce qui la situe parmi les 25 premiers émetteurs mondiaux cette année-là, selon les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Mais parallèlement la Malaisie déclare que ses forêts séquestrent de grandes quantités de CO2, en conséquence de quoi ses émissions déclarées aux Nations unies ne sont que de 81 millions de tonnes, soit moins que celles de la petite nation européenne qu’est la Belgique.
Par ailleurs, l’enquête du Washington Post a mis en évidence que les émissions de méthane ne sont pas déclarées dans la base de données de l’ONU. Des études scientifiques indépendantes montrent que les émissions anthropiques de méthane conduiraient à majorer les déclarations effectuées dans les rapports des pays à l’ONU de 57 et 76 millions de tonnes par an. Ce qui représente de 1,6 à 2,1 milliards de tonnes d’émissions équivalentes de dioxyde de carbone. Les scientifiques ont montré que les pays sous-estiment les émissions de méthane de toutes sortes : dans le secteur du pétrole et du gaz, où il s’échappe des gazoduc au niveau des stations de compression, en raison des activités d’entretien ou de petites fuites dans les pipe-lines ; dans l’agriculture, via le processus de fermentation entérique et des déchets des vaches et autres ruminants ; et dans le secteur des décharges et des déchets, généré par décomposition de déchets animaux et humains biodégradables. Les responsables de l’Union européenne estiment qu’une réduction rapide des émissions de méthane permettrait de diminuer d’au moins 0,2°C l’augmentation globale de la température mondiale d’ici à 2050. Plus de 100 pays ont à ce jour signé le Global Methane Pledge, une initiative lancée par les États-Unis et l’Union européenne, qui vise à réduire les émissions de 30% d’ici à la fin de la décennie. Mais certains des plus grands émetteurs de méthane au monde, dont la Chine et la Russie, n’ont pas encore adhéré au pacte. Le président Biden a récemment déclaré aux délégués réunis à Glasgow que la réduction des émissions de méthane était essentielle pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.
« L’une des choses les plus importantes que nous puissions faire au cours de cette décennie décisive – pour espérer rester sous la barre des 1,5°C – est de réduire nos émissions de méthane aussi rapidement que possible »
Joe Biden
Une nouvelle génération de satellites capables de mesurer les gaz à effet de serre ont été mise en orbite. Ils peuvent détecter les fuites importantes de méthane. Selon les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la Russie est le premier émetteur mondial de méthane issu du pétrole et gaz, données qui contredisent les déclarations faites par la Russie aux Nations unies. Les chiffres officiels fournis par la Russie sont inférieurs de plusieurs millions de tonnes à ce que constatent les analyses scientifiques indépendantes, selon les résultats de l’enquête du Washington Post. De la même manière, de nombreux producteurs de pétrole et de gaz dans la région du golfe Persique, tels les Émirats arabes unis et le Qatar, font état de très faibles niveaux d’émissions de méthane provenant du secteur du pétrole et du gaz, en contradiction avec l’ensemble des données scientifiques.
« Il est difficile d’imaginer comment les décideurs politiques pourraient agir de manière ambitieuse en matière de climat si d’emblée ils ne disposent pas de données valides sur l’ampleur du problème »
Glenn Hurowitz, directeur général de Mighty Earth
Les gaz fluorés, qui sont exclusivement d’origine anthropique, sont tout autant sous-déclarés. Connus sous le nom de F-Gaz, ils sont utilisés dans la climatisation, la réfrigération et l’industrie électrique. Mais le Washington Post a révélé que des dizaines de pays ne déclarent pas du tout ces émissions, ce qui constitue une lacune grave, car certains de ces puissants gaz à effet de serre contribuent de plus en plus au problème climatique mondial. Le Vietnam, par exemple, a déclaré que ses émissions de gaz fluorés ont plongé entre 2013 et 2016, pour descendre à 23.000 tonnes d’équivalent CO2. Interrogés sur l’estimation de 2016 – qui est inférieure de 99,8% à ce qu’il ressort de l’ensemble des données scientifiques – les responsables vietnamiens ont répondu que les rapports les plus récents estimaient que les gaz fluorés ne pouvaient pas fuir des systèmes de climatisation et réfrigération. Or c’est le cas : les fuites des fluides réfrigérants fluorés des supermarchés américains sont en moyenne et à ce jour estimées à 25% chaque année. Quantités de problèmes à l’origine des écarts constatés proviennent du système déclaratif choisi par les Nations unies. Les pays développés se réfèrent à un ensemble de normes bien encadrées, tandis que les pays en développement utilisent leurs propres modes de calculs, disposant d’une grande latitude quant à la manière, les critères et le moment sur les quels ils se basent pour faire leurs déclarations respectives. Cette différence est censée refléter le fait que les pays développés sont historiquement responsables de la plupart des gaz à effet de serre qui se sont accumulés dans l’atmosphère depuis la révolution industrielle et qu’ils disposent de plus de moyens techniques que les pays plus pauvres pour analyser leurs émissions. Ceci dit, même lorsque ces pays déclarent effectivement leurs émissions, les données déclarées à l’ONU ne sont pas cohérentes, loin s’en faut. Une analyse des données déclaratives montre, par exemple qu’en 2010 les terres de la République centrafricaine auraient absorbé 1,8 milliard de tonnes de carbone, une quantité si importante qu’elle compenserait largement les émissions annuelles de la Russie. Suite à la requête du Washington Post au CCNUCC concernant les données déclarées par la République centrafricaine, l’agence a éludé : « les données déclarées peuvent nécessiter des éclaircissements complémentaires ; nous les contacterons pour obtenir plus de précisions quant à leurs calculs et mettrons à jour notre base de données relative aux GES en conséquence ». Parallèlement, la République centrafricaine n’a pas répondu aux demandes de clarification du Washington Post.
« Les engagements des pays conformément à l’accord de Paris annoncés sur la base de mesures d’émissions parfaitement fantaisistes, c’est de fait comme si les parties annonçaient se mettre au régime sans jamais avoir à se peser »
Ray Weiss, un spécialiste de l’atmosphère à la Scripps Institution
Un système de déclaration criblé de failles et un sous-comptage des émissions – Au bord de l’abîme…
Les pays développés sont initialement responsables d’une majorité des gaz à effet de serre déjà présents dans l’atmosphère, et nombre d’entre eux déclarent leurs émissions chaque année suivant des procédures normalisées. Mais les pays en développement [incluant la Chine par exemple] ne sont pas tenus de déclarer leurs émissions chaque année aux Nations unies, ce qui conduit la base de données à être peu signifiante. La Chine, par exemple, premier émetteur mondial, n’a soumis des rapports que sur cinq années, le plus récent datant de 2014. En analysant les dernières déclarations à l’ONU de la totalité des 196 pays, nous avons constaté que seuls 45 d’entre eux, tous ou la quasi totalité des pays « développés », ont présenté le dernier rapport national à ce jour disponible, correspondant à l’année 2019. Certains pays qui ont des empreintes carbone importantes sont manifestement en retard : l’Iran, qui est l’un des 10 principaux responsable des émissions carbone au monde, n’a pas déposé son rapport depuis 2010 ; le Qatar, important producteur de gaz naturel, ne l’a présenté pour la dernière fois qu’en 2007 ; et l’Algérie, important producteur de pétrole et de gaz, en 2000. Rapports déclaratifs des pays lourds, incohérents, incomplets : au final les Nations unies ne disposent pas d’une base de données complète ni cohérente pour agréger les émissions de carbone des pays. Et si 148 pays n’ont pas présenté de rapport pour l’année 2019, quelques 45 pays n’ont pas communiqué de nouvelles données depuis 2009. L’Algérie, un important producteur de pétrole et de gaz, n’a pas présenté de rapport depuis 2000. La Libye, autre grand exportateur d’énergie, déchiré par la guerre, ne déclare rien de ses émissions. Le Turkménistan, en Asie centrale, dont l’économie est basée sur le pétrole et le gaz, n’a rien déclaré depuis 2010 – alors même qu’elle a été mise en cause à plusieurs reprises ces dernières années pour des fuites importantes de méthane. L’Australie ne déclare pas les émissions colossales de dioxyde de carbone dues aux méga-incendies, qui sont aggravés en raison du changement climatique. Une étude a révélé que le pays a sous-déclaré d’un facteur de quatre à sept ses émissions de protoxyde d’azote en 2016, un puissant agent de réchauffement climatique principalement issu de l’agriculture. En s’appuyant sur les données relatives aux émissions de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Washington Post a pu confirmer un écart à minima d’un facteur trois de protoxyde d’azote entre ce que l’Australie déclare aux Nations unies et la réalité. Le ministère australien de l’industrie, des sciences, de l’énergie et des ressources a contesté le fait que les émissions de carbone dues aux incendies de forêt n’étaient pas déclarées, annonçant dans un communiqué qu’il « lissait sciemment les données… afin de dégager les tendances des émissions nettes anthropiques » de ses forêts sur la durée.
Les estimations indépendantes des émissions de carbone à l’échelle de la planète font état de 57,4 milliards de tonnes d’émissions annuelles de gaz à effet de serre. L’ensemble des études scientifiques présentent des totaux similaires. Le Washington Post a créé une modèle informatique qui permet d’évaluer ce que les 148 pays qui n’ont pas présenté de rapport pour l’année 2019 auraient du déclarer compte tenu des critères précédemment appliqués. Si l’on additionne les montants d’émissions effectivement déclarées comme non déclarés, pour l’année 2019 et pour tous les pays, incluant les critères propres à chaque pays et forestiers, le total des émissions de gaz à effet de serre peut être évalué dans une fourchette de 41,3 à 44,2 milliards de tonnes. Une comparaison de ce total d’émissions avec celui des émissions calculées au niveau mondial révèle une importante sous-déclaration pouvant être évaluée à 16 milliards de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre. Cet écart de 16 milliards de tonnes ne reflète cependant pas la réalité compte tenu de l’obsolescence et incohérences des rapports nationaux, et différents autres critères par exemple liés aux transports aériens et maritimes internationaux, dont les émissions peuvent être estimés à plus d’un milliard de tonnes, qu’aucun pays ne veut assumer. En tenant compte de ces facteurs, le Washington Post a pu calculé un écart qui s’échelonne de 8,5 et 13,3 milliards de tonnes.
Les négociateurs climatiques savent depuis des décennies que ce processus de collecte de données n’est guère réaliste, mais ils ont choisi d’éluder ces problèmes et de persuader les dirigeants mondiaux de s’engager dans des discussions afin de prendre des mesures concrètes pour freiner les émissions.« Que les pays jouent à certains jeux et que l’on trouve toutes sortes d’incohérences ne me surprend pas du tout », a déclaré Dan Reifsnyder, un ancien fonctionnaire américain qui a coprésidé les négociations de l’accord de Paris. « Si vous souhaitez renforcer l’ensemble du processus, l’ensemble du processus climatique, c’est un domaine dans le quel il y beaucoup à faire. » L’accord de Paris prévoit déjà la mise en oeuvre d’un système déclaratif censé être mieux encadré d’ici à la fin 2024, mais il semblerait qu’il faille encore attendre 2030 pour parvenir à de véritables avancées, incluant notamment des rapports robustes – une éternité alors que les délais se resserrent face à une échéance climatique qui se rapproche. Le monde s’est déjà réchauffé d’au moins 1,1°C par rapport aux niveaux préindustriels, ce qui réduit de plus en plus nos marges de manœuvre pour éviter de franchir les seuils de réchauffement dangereux de 1,5 à 2°C. Selon les scientifiques, les émissions, qui continuent de grimper, devraient être réduites de moitié au cours de cette décennie, et pas ultérieurement, dans le cadre de ce qui devrait être la plus grande action collective entreprise par l’ensemble des pays du monde dans l’histoire de l’humanité. Pourtant, au final, ce ne sont pas les politiques, les critères comptables ou les engagements des différents pays qui permettront de déterminer avec précision l’ampleur des risques et enjeux liés au réchauffement de la planète, mais plus directement les chiffres calculés par la science atmosphérique : les parties par million de gaz à effet de serre dans l’air. Dans une récente interview, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré qu’il espérait que les pays prendraient enfin conscience des conséquences de leurs actions : « On prend de plus en plus conscience que nous sommes vraiment au bord de l’abîme, a-t-il déclaré. Et lorsque vous êtes au bord de l’abîme, vous devez être très prudent quant à votre prochaine étape.»
Comment combler l’écart ?
L’étude faite par le Washington Post des rapports nationaux soumis aux Nations unies a révélé une importante sous-déclaration des émissions de gaz à effet de serre, évaluée de 8,5 à 13,3 milliards de tonnes. La majeure partie de l’écart provient de la manière dont les pays comptabilisent les émissions de dioxyde de carbone provenant des terres. Les terres peuvent absorber du carbone lorsque les plantes poussent et que les sols sont en mesure de le séquestrer, ou bien libérer du carbone dans l’atmosphère lorsque les forêts sont exploitées ou brûlées et que les tourbières sont drainées.
Un abîme…
Au début de l’année 2020, M. Ciais, expert français en matière d’émissions carbone, n’a pu accéder à son laboratoire à l’université de Paris-Saclay, un pôle de recherche situé en dehors de la capitale. Le laboratoire étant fermé pendant la pandémie de coronavirus, M. Ciais est resté chez lui et a fait ce qu’il fait toujours : de la recherche. Cette année-là, il a publié plus d’une centaine d’articles scientifiques, la majorité consacrés à la résolution de certains des problèmes les plus complexes de la science du climat : quelles sont les émissions réelles de la planète ? Et dans quelle mesure la planète – par ses terres, forêts et sols – contribue-t-elle à atténuer la pollution mondiale ?Au printemps 2020, le confinement a fait chuter les émissions de dioxyde de carbone, ainsi que les prix du pétrole. Le professeur Ciais a profité de ce moment unique pour étudier les émissions des pays. Il a rassemblé les rapports d’émissions déposés aux Nations unies et les a comparé aux données satellitaires et atmosphériques de la croissance des forêts et des émissions de méthane et d’oxyde nitreux des plus grands émetteurs mondiaux. Il s’attendait à un écart et s’interrogeait quant à son amplitude. Mais alors qu’il constatait qu’il s’agissait plutôt d’un gouffre, il a immédiatement compris les implications pour les politiques liées à l’accord de Paris : « Il est déjà difficile de donner un sens aux engagements pris par les différents pays, a-t-il déclaré. Si en plus les données de référence sont sous-déclarées, les niveaux de réduction des émissions obtenus seront irréalistes ».L’étude de Ciais sur l’année 2021, menée avec Zhu Deng de l’université Tsinghua à Pékin et 31 autres chercheurs, est toujours en attente d’évaluation par les pairs, mais est accessible au public, de même que son ensemble de données. L’étude se base sur certains des rapports nationaux analysés par le Washington Post, ainsi que des ensembles de données atmosphériques déjà publiés par le Global Carbon Project. Mais elle ne portent que sur un certain nombre de pays pris un par un, non sur la totalité des pays à l’échelle mondiale comme l’a fait le Post. Elle révèle de même des écarts importants entre les déclarations de leurs émissions par les pays et la réalité. En particulier, Ciais a démontré que certains des principaux émetteurs mondiaux, y compris des pays riches et en développement tels que la Russie, l’Indonésie, l’Union européenne et le Brésil sous-estiment les émissions de gaz à effet de serre. Dans l’un des cas les plus caricaturaux, l’étude de Ciais a révélé que les fuites de méthane provenant de l’exploitation de combustibles fossiles dans les États pétroliers du golfe Persique pourraient être jusqu’à sept fois supérieures à ce qu’ils déclarent officiellement. Ses recherches ont également montré que les « puits de carbone » naturels (les terres et forêts capables d’absorber le CO2) sont largement sous-estimées par les pays. Mais, pour Ciais, les conclusions de cette analyse demeurent en demi-teinte : certes, la Terre participe à la séquestration du carbone plus qu’escompté par certains pays. Reste que les sécheresses, incendies de forêt et autres dégradations majeures induites par le changement climatique pourraient rapidement rejeter une grande partie de ce carbone. Les gaz à effet de serre libérés par les activités humaines sont difficiles à définir : par définition, ils sont invisibles, et sont produits par presque tous les aspects de nos vies. Les maisons dans lesquelles nous vivons, les véhicules que nous conduisons, les aliments que nous mangeons, les produits que nous achetons contribuent tous, directement ou indirectement, à la charge en gaz à effet de serre de l’atmosphère. Une grande partie des émissions provient de la combustion de combustibles fossiles, qui peut être comptabilisée avec une précision raisonnable. Mais plus du tiers d’entre elles ne sont pas faciles à évaluer, notamment les émissions qui résultent de l’abattage des forêts ou des incendies, de l’assèchement des tourbières ou de l’épandage d’un excès d’engrais sur les champs agricoles.
Pour Ciais, il n’y a rien d’étonnant à que les dirigeants du monde aient du mal à comptabiliser les échanges complexes de carbone et d’azote entre la Terre et son atmosphère. Sauf que le système mis en place par les Nations unies pour comptabiliser ces émissions rend les choses encore plus difficiles. L’une des principales limites est que les directives de l’ONU en matière de déclaration ne requièrent aucune mesure atmosphérique ou satellitaire, ce que l’on appelle une approche « descendante ». Elles supposent plutôt une approche comptable, dans la quelle les scientifiques de chaque pays sont supposés quantifier les niveaux d’émissions d’activités spécifiques. Il peut s’agir du nombre de vaches, dont le processus de fermentation entérique représente 4% du total des gaz à effet de serre, de la quantité d’engrais utilisée ou de la superficie de tourbières converties en terres cultivées au cours d’une année. Les pays multiplient ces unités par un « facteur d’émission » – une estimation de la quantité de gaz produite par chaque activité – afin d’estimer un bilan global, en passant par les « rots » des vaches jusqu’aux émissions des pots d’échappement des véhicules. Mais ces chiffres sont sujets à des marges d’erreurs colossales, tout comme ce qui est considéré comme « facteur d’émission ». Au final, le bilan déclaratif des émissions n’est pas autre chose qu’une conjecture, un cas de « garbage in, garbage out » [en informatique, on parle de GIGO (pour « garbage in, garbage out »), un concept selon lequel les meilleures modélisations peuvent, dès lors que les données d’entrée sont faussées ou absurdes, produire en sortie des résultats absurdes, dits « déchets ». Ndlr].
Les données fantaisistes de la Malaisie illustrent de manière frappante le niveau particulièrement élevé des enjeux auxquels les pays sont confrontés alors qu’ils doivent faire face à la pression croissante pour réduire leurs émissions tout en gérant très concrètement les conséquences économiques des décisions qui s’imposent. Au cours de la dernière décennie, des efforts considérables ont été déployé par certains dans ce pays d’Asie du Sud-Est pour contrer les conclusions scientifiques selon lesquelles l’industrie de l’huile de palme conduit à l’émission de quantités colossales de carbone. L’Union européenne a limité les biocarburants à base d’huile de palme au motif que cette industrie contribue à la déforestation, et les États-Unis ont interdit les importations d’huile de palme de deux des plus grands producteurs malaisiens au cours des 18 derniers mois en conséquence de conditions de travail jugées abusives dans ces plantations. En 2016, dernière année où la Malaisie a fourni son rapport déclaratif aux Nations unies, les experts mondiaux des tourbières se sont réunis à Kuching, la capitale de l’État malaisien du Sarawak, pour le 15e Congrès international de la tourbe, sur la vaste île tropicale de Bornéo. Jenny Goldstein, alors nouveau membre de la faculté de l’université Cornell, a été logé dans un hôtel cinq étoiles Pullman Kuching et a pu découvrir à quel point il a été l’objet d’efforts de manipulation colossaux visant à donner une bonne image de l’industrie controversée de l’huile de palme.Au sein de cette conférence académique censée regrouper des scientifiques, il y avait au final plus de participants liés à l’industrie de l’huile de palme que de scientifiques. L’immense salle de bal de l’hôtel était réservée aux conférences organisées par les industriels, pendant que les conférences scientifiques se tenaient au sous-sol, dans des salles si petites que certains scientifiques devaient s’asseoir à même le sol. Goldstein s’est aventuré dans la salle de bal et témoigne : « Il n’y avait quasi que des hommes assis dans cette immense salle, à l’écoute des conférenciers qui présentaient la manière dont les superbes tourbières de Malaisie ont été remodelées au bénéfice des productions d’huile de palme », se souvient-il, pendant que dans les sous-sols les experts mondiaux de la tourbe présentaient les toutes dernières recherches sur les colossales bombes de carbone que représentent les tourbières. Le Sarawak peut s’enorgueillir d’un riche écosystème de forêts de marécages tourbeux qui abritent des orangs-outans, des crocodiles et des raminiers de 30 mètres de haut jaillissant de la terre détrempée. Mais à travers le Sarawak et d’autres régions de Malaisie, 10.000 km², soit 1 million d’hectares de ces forêts, soit à peu près la taille du Connecticut, ont été drainés au cours des dernières décennies. Une grande partie de ces terres est aujourd’hui consacrée aux plantations d’huile de palme, couramment utilisée dans des produits aussi divers que les biocarburants ou les aliments transformés, en passant par les savons et le maquillage. Les tourbières sont constituées de matières organiques peu dégradées dans un environnement gorgé d’eau stagnante, donc très appauvrie en oxygène, qui inhibe la décomposition des débris végétaux. Lorsqu’elles sont drainées, elles libèrent en quantité du dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre, car les matières organiques constitutifs de la tourbe se dégradent en raison de leur exposition soudaine à l’air. Les émissions peuvent se poursuivent pendant des décennies, jusqu’à la disparition complète de la tourbe. Cette conférence constituait un événement historique pour un pays tropical, organisée pour la première fois dans un tel pays en 62 ans d’existence, accueillie par la Malaysian Peat Society avec le soutien du gouvernement local du Sarawak. Lulie Melling, responsable de la conférence, directrice de l’Institut de recherche sur les tourbières tropicales du Sarawak et titulaire d’un doctorat en sciences environnementales de l’université japonaise d’Hokkaido, affirmait que les producteurs de palmiers à huile étaient en mesure de gérer de telles plantations sur les tourbières sans conséquences sur les émissions de carbone. Dans une interview accordée au Washington Post, Mme Melling a déclaré que les questionnements des scientifiques étaient inappropriés, qui se basent sur leurs connaissances de la tourbe acquises dans d’autres régions du monde, et étaient en conséquence incapables de comprendre les qualités uniques de la tourbe de sa région. « C’est comme comparer un gâteau au fromage avec du fromage suisse », a-t-elle déclaré. Manifestement, le débat perdait en objectivité scientifique pour prendre une tournure nationaliste et anticolonialiste. Plus tôt dans l’année, elle a déclaré au New Sarawak Tribune, un journal anglophone, que l’Institut national de recherche sur les tourbières tropicales était « à la pointe des recherches, qui démontraient que les pratiques agricoles sur les tourbières n’impactaient quasi pas leur capacité de séquestration de carbone ».« À moi seule, avec le soutien de ma petite équipe, , a-t-elle déclaré, j’ai effectué et publié des travaux de recherche révolutionnaires sur l’usage de la tourbe et les émissions [de gaz à effet de serre] afin de réfuter les arguments des chercheurs occidentaux qui s’opposent à la récupération de la tourbe comme terre arable ». Selon Mme Goldstein, la position pro-industriels de Mme Melling a pris de court les scientifiques présents à la conférence, tout comme son usage d’un langage vulgaire dans ses commentaires publics. Mme Melling a répondu qu’elle choisissait d’utiliser un langage suggestif pour marquer les esprits. « J’ai commencé à utiliser l’humour pour faire passer mon message en 2007, lorsque j’ai organisé un séminaire sur la science du sol intitulé « Big hole, small hole & KY Jelly » », a-t-elle déclaré dans une interview d’avril 2016 avec TTG Associations, un groupe commercial de la région Asie-Pacifique. Le lendemain de la conférence, certains scientifiques ont été ébahis de lire des reportages qui indiquaient que l’événement avait été l’occasion de démontrer que le développement de l’huile de palme pouvait se faire sans perturbation majeure pour l’environnement. « La Malaisie met au défi le monde sur l’intérêt de produire de l’huile de palme sur les tourbières », a déclaré le Jakarta Post en anglais. En réponse, 139 scientifiques – dont Goldstein – se sont opposés à ces articles, soulignant le nombre d’études évaluées par des pairs sur les émissions des tourbières. La lettre a été publiée par la revue scientifique Global Change Biology. « Mais l’industrie des palmiers à huile est directement liée aux intérêts gouvernementaux », a déclaré M. Goldstein._
Une chaleur brûlante
Nicholas Mujah Ason a vécu à la fois les causes et les conséquences du réchauffement climatique : les plantations de palmiers à huile à perte de vue comme la forêt tropicale qui demeure désespérément chaude. Mujah a vécu dans l’État du Sarawak la majeure partie de sa vie. Il combat le développement depuis le début des années 1980, date à la quelle il a été emprisonné pour avoir voulu s’interposer face aux agissements des bûcherons. « Ce n’est pas tant que nous sommes contre l’huile de palme, a-t-il précisé. Nous détestons la manière dont l’huile de palme a été plantée sur nos terres ». Sa famille vit au plus profond de la forêt tropicale depuis huit générations. Cet homme de 62 ans a été impliqué dans de multiples actions en justice en tant que secrétaire général de l’association Sarawak Dayak Iban, un groupe de défense des droits des autochtones. Récemment, le village natal de Mujah a été victime d’inondations inopinées, parce que les tourbières qui autrefois absorbaient les pluies ont été drainées. Il est désormais difficile de savoir quand l’été commence, car il fait chaud toute l’année – et la chaleur brûle. « Ce n’est pas une chaleur normale comme celle que nous connaissions avant, c’est une chaleur mordante, et le soleil brûle votre peau. » Pourtant le gouvernement malaisien a systématiquement minimisé l’impact climatique de l’industrie de l’huile de palme dans ses rapports à l’ONU. En 2016, la Malaisie a déclaré qu’elle n’avait pas converti un seul hectare en terres cultivées.« C’est manifestement faux », a déclaré Susan Page, experte des tourbières à l’Université de Leicester, qui a également signé la lettre s’opposant aux présentations officielles du Congrès international des tourbières de 2016. Alors qu’en réalité, dans une étude validée par des pairs et pourtant financée par le gouvernement malaisien, des scientifiques ont étudié les conséquences d’une plantation de palmiers à huile sur une tourbière riche en carbone au Sarawak, l’année du dernier rapport déclaratif de la Malaisie. L’étude a estimé que 138 tonnes de carbone par hectare étaient libérées dans les zones converties. Autrement dit, la conversion des terres a conduit à une explosion des émissions. À la demande du Washington Post, la société « d’intelligence géospatiale » Esri (https://www.esri.com/fr-fr/home) a calculé qu’au total 200 hectares de terres on été converti. Et ces conversions ont été réalisées dans tout le pays cette même année. En s’appuyant sur un ensemble de données satellitaires compilées dans l’étude de Ciais & al., dont Wei Li de l’université de Tsinghua en Chine, l’Esri a évalué à 170.000 hectares nets les nouvelles plantations de palmiers à huile en 2016, malgré la difficulté de déterminer avec précision la part de plantations réalisées sur des tourbières. Les études scientifiques ont démontré que le pays a également largement sous-estimé les émissions issues du drainage des tourbières, qui sont émises dans les années suivant la conversion des terres. Le pays a ainsi avancé que suite au drainage des tourbières, les changements d’usage des terres n’auraient conduit qu’à l’émission de 29 millions de tonnes de CO2 en 2016. John Couwenberg, un expert des tourbières de l’université de Greifswald en Allemagne, a déclaré que l’estimation avancée par la Malaisie était « particulièrement sous-évaluée ». Sur la demande du Washington Post, son analyse lui a permis d’estimer ces émissions à 111 millions de tonnes d’émissions équivalentes de carbone. Une étude de 2017 a conclu à une estimation comparable, d’environ 100 millions de tonnes de carbone par an pour la Malaisie. Autrement dit, les émissions liées au drainage des tourbières en Malaisie sont approximativement trois fois supérieures aux annonces gouvernementales.
Mais ces points ne représentent que la cerise sur le gâteau….
La Malaisie avance que ses forêts constituent un puits de carbone annuel de plus de 243 millions de tonnes pour une superficie forestière de seulement 180.000 km² (18 millions d’hectares). Ce qui se rapproche de ce qui est déclaré par l’Indonésie voisine pour une forêt plus de cinq fois plus grande.Les experts de l’ONU ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une « valeur inhabituellement élevée » et ont rétorqué qu’il était impossible d’aboutir à un tel montant de séquestration du carbone pour les forêts malaisiennes malgré l’utilisation de trois méthodologies différentes. Plusieurs scientifiques ont confirmé au Washington Post cette incohérence, considérant que cette estimation ne pourrait avoir de sens que si la totalité des forêts de Malaisie était en forte croissance, ce qui est loin d’être le cas. « Il y a manifestement erreur, car il est strictement impossible de penser que l’ensemble des forêts de Malaisie soient en pleine croissance telles de jeunes forêts tropicales », a déclaré Jérôme Chave, directeur de recherche au Centre national français de la recherche scientifique, qui a publié des études sur la séquestration du carbone dans les forêts malaisiennes. Pourtant le gouvernement malaisien a confirmé que ses rapports étaient conformes aux directives de l’ONU et faisaient l’objet d’un examen rigoureux, même il n’a pas répondu aux questions détaillées relatifs aux rapports du pays sur les terres.« L’ensemble des informations, incluant celles pour les quelles un complément d’information est requis, a été soumis à un processus d’examen approfondi, qui nous a demandé sept mois de travail, supervisé par les experts indépendants de la CCNUCC », a rétorqué Mohamad Firdaus Nawawi, fonctionnaire du ministère malaisien de l’Environnement et de l’Eau, qui a la responsabilité des rapports en question. « Considérer les tourbières, c’est s’inscrire dans une histoire de plusieurs milliers d’années d’accumulation de carbone », a déclaré Hurowitz, directeur général de Mighty Earth. « Le Sarawak a travesti l’intégrité des réunions scientifiques, gouvernementales et d’entreprises pour légitimer la destruction des tourbières depuis de longues années, jusqu’à mettre en avant une image complètement déformée des conséquences la destruction de ces écosystèmes si riches en carbone. ». Dans le cadre de l’accord de Paris, la Malaisie s’est engagée à réduire, d’ici la fin de la décennie, les émissions nettes de carbone de son économie de 45% par rapport à 2005. Et jusqu’à ce jour, le pays met en avant son secteur forestier pour justifier de la réduction de ses émissions, ce qui souligne à quel point les chiffres avancés par le pays sont fondamentalement problématiques. « Il n’est pas surprenant que les gouvernements cherchent à s’arranger avec les chiffres », a déclaré M. Hurowitz, « mais il est honteux qu’ils puissent s’en tirer à si bon compte. »
Tolérer le désordre
Jackson, professeur à Stanford, considère qu’une bonne connaissance des données est une base indispensable si l’on veut pouvoir « sauver la planète du péril climatique ». Il préside le Global Carbon Project, qui a pour ambition de compiler les données scientifique permettant d’appréhender le cycle global du carbone, autrement dit, les processus qui conduisent la planète à séquestrer et émettre du dioxyde de carbone. Les scientifiques effectuent des synthèses à partir des même données que celles utilisées par les pays pour déclarer leurs émissions aux Nations unies, sauf que leurs analyses sont marquées du sceau du scepticisme, et sont complétées par des mesures directes des gaz dans l’atmosphère. M. Jackson avance que les données atmosphériques sont l’ultime moyen de vérifier la conformité des déclarations, et donc des engagements par pays. Le manque de données est un problème urgent. En début d’année, les Nations unies ont publié un « rapport de synthèse », censé présenter l’effet des promesses climatiques des pays sur les émissions futures et la température de la planète. Selon ce rapport, ces promesses sont censées « couvrir » l’immense majorité des émissions mondiales, mais les chiffres réels sont supérieurs de plus de 10 milliards de tonnes à ce que les pays déclarent réellement lorsque tous les secteurs sont pris en compte, selon les calculs du Washington Post. Les Nations unies ont refusé de nous ouvrir leur base de données, qui aurait permis d’étayer avec plus de précision ce différentiel, et se sont contenté de décrire les processus par lesquelles les « chiffres » déclarés par les différents pays avaient été ajustés. « Il est interrogeant de constater que les auteurs du rapport de l’ONU ne se sont pas contentés d’utiliser les données brutes déclarées par chaque pays », a déclaré M. Ciais, qui contribue également au Global Carbon Project. M. Saier, le porte-parole de la CCNUCC, a défendu cette approche, confirmant que, « concrètement, une mise à l’échelle était effectuée ». Au final, la CCNUCC compense donc les valeurs déclarées pour qu’au final il y ait correspondance avec les données mondiales globales, ce qui permet à priori d’éliminer l’écart constaté par le Washington Post. D’un point de vue politique, il est possible qu’il n’y ait pas d’alternative. Si les mesures par satellite et atmosphériques ne sont pas exigées, les pays riches comme pauvres ont toute latitude pour ne pas déclarer l’ensemble de leurs émissions pendant des années. Et il n’est pas prévu de moyen contraignant pour rendre obligatoire les conséquences liées à l’accord de Paris, la mise en œuvre de stratégies de réductions d’émissions ou la déclaration de rapports cohérents sur les émissions.
« Chaque pays déclare ce qu’il déclare et promet ce qu’il promet. »
Jackson, professeur à Stanford
« Je pense que c’est en bonne partie la raison pour laquelle tout cela est toléré, le sentiment prédominant est qu’au moins certains pays s’engagent sur quelque chose, participent et y réfléchissent », a déclaré M. Jackson. « C’est pourquoi tous tolèrent ces insuffisances, l’alternative étant que les pays s’écartent définitivement du processus ». Mais Jackson est un optimiste. « Je crois que fondamentalement l’information est une force colossale. Les données et informations n’ont pas fait bouger le monde aussi rapidement que je l’aurais souhaité, a-t-il énoncé. Mais j’espère toujours naïvement laisser à mes enfants un monde meilleur que celui que j’ai trouvé. »
DÉCOUVREZ NOTRE DOSSIER SUR LA COP26
Enquête réalisée par le Washington Post, par Chris Mooney, Juliet Eilperin, Desmond Butler, John Muyskens, Anu Narayanswamy and Naema Ahmed.Avec la contribution de Brady Dennis, Nick Trombola, Taylor Telford et Caroline Cliona Boyle.A propos de reportage :Montage du projet par Trish Wilson. Edition des données par Meghan Hoyer. Montage graphique : Monica Ulmanu. Graphisme : Naema Ahmed. Montage photo et gestion de projet par Olivier Laurent. Photographies : Helynn Ospina, Heather Ainsworth et Cyril Zannettacci/Agence VU. Rédaction du design par Matthew Callahan. Conception et développement : Garland Potts. Rédaction : Anastasia Marks.Chris Mooney est journaliste lauréat du prix Pulitzer qui couvre le changement climatique, l’énergie et l’environnement. Il a notamment réalisé des reportages sur les négociations climatiques de Paris en 2015, le passage du Nord-Ouest et la calotte glaciaire du Groenland, et a écrit quatre livres sur la science, la politique et le changement climatique.Juliet Eilperin est journaliste lauréate du prix Pulitzer au Washington Post, où elle rédige des articles sur le climat et l’environnement. Elle a écrit deux livres, « Demon Fish : Travels Through the Hidden World of Sharks » et « Fight Club Politics : How Partisanship is Poisoning the House of Representatives ».Desmond Butler est journaliste d’investigation au sein de l’équipe climat et environnement du Washington Post. Il a précédemment travaillé pour l’Associated Press à Washington, Istanbul et New York. Son travail a mis en lumière des entrepreneurs militaires sans scrupules, des campagnes de désinformation et la contrebande nucléaire. Il a également été le correspondant en chef de l’AP en Turquie.John Muyskens est rédacteur graphique au Washington Post, spécialisé dans les reportages nécessitant de travailler sur des données.Anu Narayanswamy est journaliste spécialiste des données au sein de l’équipe nationale chargée de l’entreprise politique et de la responsabilité au Washington Post, et plus particulièrement de l’argent et de la politique.Naema Ahmed est reporter graphique au Washington Post. Avant de rejoindre le Post, elle a travaillé chez Axios en tant que conceptrice de visualisation de données.
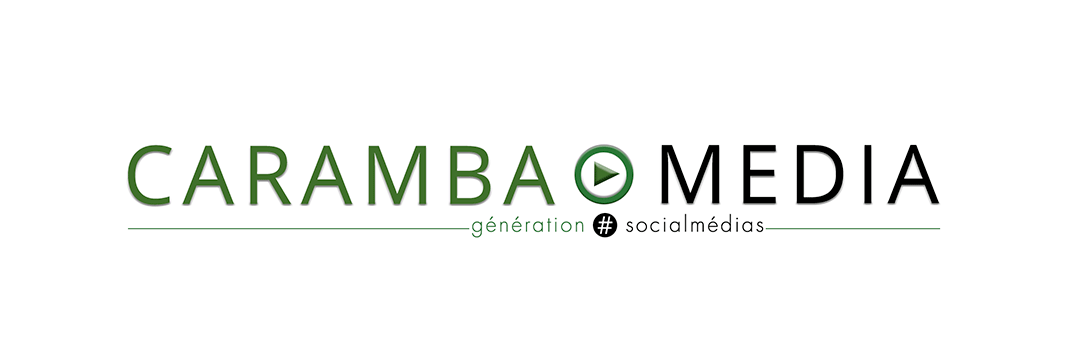


Commentaires récents